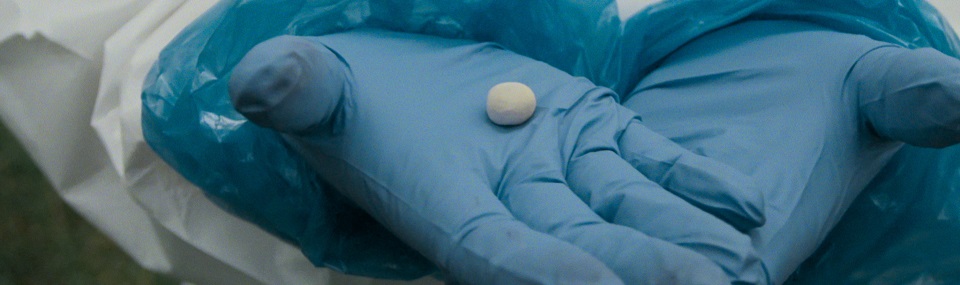Sylvain George • Réalisateur
"Télescoper, réinscrire dans le temps long"
par Bénédicte Prot
- Entretien avec Sylvain George, l'auteur de Paris est une fête - Un film en 18 vagues, une déambulation hypnotique et radicale dans les hauts-lieux et les interstices de la capitale française

À l’occasion de la présentation de Paris est une fête - Un film en 18 vagues [+lire aussi :
critique
bande-annonce
interview : Sylvain George
fiche film] au festival Cinéma du Réel et de sa sortie prochaine, avant de reprendre le projet sur Calais qu’il a interrompu pour filmer trois des manifestations qui ont secoué la Place de la République en 2015 et 2016 – et, parallèlement à ce furieux jaillissement de résistance collective, la vie humaine réduite à sa plus simple essence, à sa liberté individuelle la plus nue, qui s’organise dans les brèches, sur les trottoirs où dorment les réfugiés –, le cinéaste, écrivain et poète Sylvain George nous parle de cette oeuvre qui crée un contact immédiat, électrisant, avec une vérité intense, totalement présente en même temps qu’elle sourd dans la nuit des temps.
Cineuropa : Vous avez choisi pour ce film un titre aux évocations multiples.
Sylvain George : L’idée était de détourner des mots confisqués des usages qui en ont été faits. Paris est une fête, c’est d’abord un roman d’Hemingway, redevenu célèbre après qu’une dame l’ait cité dans une chaîne d’info en continu couvrant les attentats, repris dans la foulée par la Mairie de Paris pour promouvoir la culture et le tourisme... La même chose vaut pour "vague", un mot très polysémique souvent confisqué, souvent dans le sens d’une stigmatisation des personnes (on parle de "vague" d’immigration, mise au même niveau que la "vague d’attentats") dont je voulais jouer en l’élargissant, parce qu’il renvoie aussi au témoignage de mon protagoniste, Mohamed, quand il raconte sa traversée en bateau, et puis à sa situation de "naufragé sans spectateur", comme dit Lucrèce par rapport à la réaction qu’on a quand un naufragé tombe, quand on l’a laissé s’échouer – ce qui fait référence à un positionnement éthique et politique. La vague évoque en outre l’idée de répétition du même, mais qui peut aussi créer de la différence, laisser émerger des choses nouvelles, des gestes nouveaux capables, peut-être, de renverser un certain état des choses.
Au-delà de la réalité qu’il dépeint, la forme du film (notamment le travail très soigneux sur l’image et le son et leur dialogue) détermine l’expérience qu’il nous fait vivre, et pourtant vous avez saisi des événements que vous ne pouviez pas prévoir. Comment avez-vous façonné ce parcours ?
J’ai toujours essayé d’explorer la plasticité du médium cinématographique, de jouer avec le son, les images, les couleurs, le noir et blanc, les rythmes, pour créer un langage qui se définit petit à petit et rompt avec la grammaire généralement associée au cinéma documentaire. En travaillant sur les ressources du médium, on peut attester de vérités de manière singulière, transmettre non seulement des idées mais aussi des sensations. Et c’est l’ensemble de ces éléments là qui, par un jeu un peu foisonnant parfois, permet de traduire, et de définir aussi, mon positionnement par rapport aux situations rencontrées. Car l’idée est de m’attacher au sujet rencontré. En apprenant à connaître Mohamed, en déambulant avec lui, en passant de lieux centraux (les "hyper-lieux" de Michel Lussault) aux interstices (ou hors-lieux), j’ai pu voir comment des décisions politiques peuvent agir sur les corps, les récits, les lieux. Et puis petit à petit, à travers des éléments qui viennent se télescoper, d’autres motifs viennent, plus indirectement, s’entrechoquer. Donc c’est un film qui d’une certaine façon téléscope des scènes ou événements qui pourraient paraître très séparés les uns des autres mais qui en fait ne le sont pas du tout, ce qui permet aussi de se réinscrire dans le temps long, d’inscrire un certain nombre d’événements qui participent de l’actualité dans l’inactualité, et ce de manière plastique, dans le cadre d’une recherche cinématographique qui elle aussi s’inscrit dans le temps long puisqu’elle dialogue avec des formes qui renvoient aux débuts de l’histoire du cinéma – au "film de ville", à Vertov...
En effet, si le film est porté par un mouvement vers l’avant, chaque fragment (geste, objet) qui le constitue invite à être exploré dans son épaisseur, sa durée, comme ce carnet d’écriture que rédige ce réfugié afghan...
Ça, c’est ce qu’on pourrait appeler un geste. Des spectateurs m’ont demandé après avoir vu le film où était la "fête" et justement, je trouve que dans ce geste, il y a quelque chose de très joyeux - parce que la joie, elle est aussi dans ce sentiment, ce geste aussi de résistance, ce travail qu’un individu peut effectuer dans la définition de son intimité, la recherche de sa propre liberté. Il y a là quelque chose de joyeux. Cette joie s’exprime dans des gestes de différentes natures : le carnet, les gestes de certains manifestants, la chorégraphie très expressive des mains de Mohamed dans la nuit. Tout cela renvoie à ce que Frantz Fanon appelait les "fêtes de l’imaginaire", c’est-à-dire que l’appel à l’imagination permet de décloisonner, de déverrouiller des situations complètement forcloses et ainsi ouvrir les espaces, les temporalités. Ça permet de s’ouvrir à quelque chose d’impossible, en fait.
Vous avez vraiment filmé les manifestations de l’intérieur, au coeur de l’action, et en voyant le film, on se dit que l’opération a dû être difficile et risquée.
Je travaille toujours avec la même caméra qui est un dispositif très simple, c’est-à-dire une très bonne caméra, visible mais pas trop ostentatoire, avec deux prises micro pour avoir une palette sonore plus riche. Après, dans une manifestation comme ça, c’est très difficile parce qu’on se retrouve assigné à une place qui n’est pas la sienne, c’est-à-dire qu’on est pris dans un entre-deux : on est ciblé par la police (j’ai reçu les gaz lacrymogènes à tir tendu, des grenades de désencerclement dans les jambes) et en même temps, on éveille la suspicion des manifestants, qui ont une certaine idée des médias et craignent l’instrumentalisation, perçue comme partisane, qu’ils pratiquent. On peut le comprendre, je comprends le côté prédateur de la caméra – quoique je déteste moi-même les généralisations, car il importe, surtout dans les mouvements de masse, d’avoir une rigueur critique, y compris dans l’action : on n’est pas forcé de céder à la suspicion généralisée par rapport aux médias, et d’ailleurs le geste anti-média, c’est aussi une posture qui fait partie de la "panoplie" du militant. Quoiqu’il en soit, la situation où j’étais est intéressante parce qu’elle interroge d’autant plus la façon de se présenter – quand on fait un film en tant que cinéaste, je considère qu’il est important de se présenter. Là, c’est difficile, mais j’ai essayé d’être clair par rapport à mon positionnement dans l’espace.
Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre newsletter et recevez plus d'articles comme celui-ci, directement dans votre boîte mail.